L'évolution des connaissances en neurosciences a profondément transformé notre compréhension de la réhabilitation auditive. Autrefois perçue comme une simple amplification sonore, la prise en charge de l'hypoacousie est désormais envisagée comme un processus impliquant la réorganisation cérébrale.
Explorons ensemble comment les aides auditives stimulent la plasticité neuronale et favorisent une réadaptation fonctionnelle.
La neuroplasticité dans le cortex auditif

La neuroplasticité peut se définir comme la capacité du cerveau à se modifier et à se réorganiser en réponse à des stimuli sensoriels. Dans le domaine auditif, ce processus permet d'ajuster les connexions neuronales pour compenser une perte d'audition ou améliorer la discrimination des sons. Kral & Eggermont, en 2007, ont montré que, même à l'âge adulte, l'activation des aires auditives peut entraîner des changements structurels et fonctionnels dans le cortex. Une plasticité intermodale existe même, c'est-à-dire que des régions cérébrales non auditives peuvent être recrutées pour compenser une perte auditive, ce qui suggère une réorganisation cérébrale plus étendue que ce que l’on pouvait penser (Sharma et al., 2015). Ces phénomènes ne se limitent donc pas à une réorganisation locale du cortex auditif, car des régions impliquées dans la mémoire, l'attention et d'autres fonctions cognitives participent également à l'intégration des signaux acoustiques.
On sait désormais que l'utilisation des aides auditives dépasse la simple amplification du son. La neuro-imagerie fonctionnelle a mis en évidence que l'activation des aires auditives est significativement améliorée chez les utilisateurs réguliers d'aides auditives (Peelle, 2017). Le port régulier d’aides auditives, entraîne en effet une stimulation bénéfiques des voies auditives. Cette stimulation favorise donc la réactivation de réseaux neuronaux qui, en l'absence de stimuli suffisants, auraient commencé à se détériorer. Le phénomène de recalibrage neuronal est central dans ce processus. En recevant un signal acoustique mieux défini, le cerveau ajuste ses connexions synaptiques pour optimiser le traitement de l'information. Ce réajustement conduit à une meilleure discrimination des sons et réduit l'effort cognitif nécessaire pour interpréter des signaux partiellement dégradés. Les travaux de Lin et collaborateurs démontrent une corrélation entre l'utilisation précoce des aides auditives et l'amélioration des fonctions cognitives, notamment chez les personnes âgées (Lin et al., 2013). Ce constat renforce l'idée que la réhabilitation auditive a des effets bénéfiques étendus, incluant aussi une protection contre le déclin cognitif associé à l'hypoacousie.
Implications pour la réhabilitation auditive
La prise en compte des mécanismes de neuroplasticité dans les protocoles de réhabilitation auditive permet d'envisager une prise en charge globalement personnalisée. Le rôle de l'audioprothésiste ne se limite pas à la fourniture et au réglage d’aides auditives, l’accompagnement pédagogique est tout aussi important pour expliquer aux patients comment leur cerveau peut réapprendre à traiter les signaux sonores. Une bonne communication sur le fonctionnement de la plasticité neuronale aide à surmonter les freins psychologiques liés à la peur de l'échec ou à l'inquiétude quant à leur adaptation à l’amplification.
L'efficacité de la rééducation auditive est renforcée lorsque l'ajustement technique des aides auditives est couplé à des exercices de stimulation cognitive. Des protocoles intégrant des séances d’entraînement auditif et des interventions de thérapie cognitive ont démontré une capacité accrue à favoriser la formation de nouvelles connexions synaptiques, améliorant ainsi l'intégration des signaux acoustiques (Rönnberg et al., 2016). Ces recherches apportent par exemple un éclairage intéressant sur le modèle ELU (Ease of Language Understanding), qui décrit comment une stimulation auditive optimisée peut soutenir la compréhension du langage dans des environnements complexes.
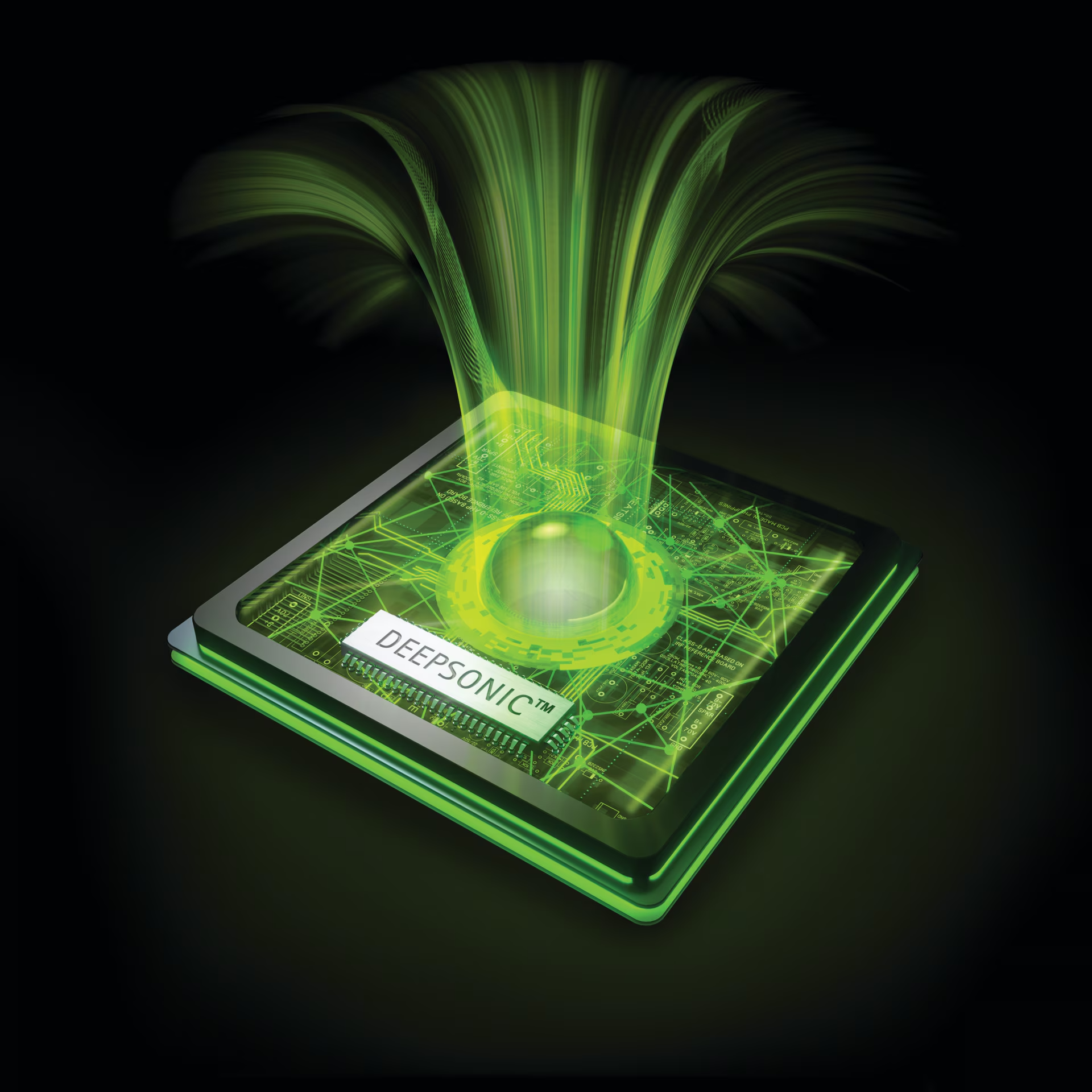
Les avancées technologiques ouvrent de nouvelles perspectives pour la réhabilitation auditive. L'intégration d'algorithmes d'apprentissage automatique dans les aides auditives permet d'ajuster en temps réel les paramètres de traitement du signal en fonction des environnements acoustiques et des besoins individuels du patient. Ces innovations, associées à une meilleure compréhension des mécanismes de neuroplasticité, devraient conduire à des stratégies de réhabilitation toujours plus personnalisées.
Des études longitudinales ont été menées il y a une quinzaine d’années afin d'évaluer l'impact à long terme des aides auditives sur l'organisation cérébrale. Ces recherches visaient notamment à identifier des biomarqueurs qui pourraient prédire la réussite de la réhabilitation auditive et à affiner les protocoles de prise en charge pour prévenir le déclin cognitif associé à une stimulation auditive insuffisante (Wong et al., 2009).
Conclusion
La prescription et l'utilisation régulière d’aides auditives déclenche des processus de réorganisation neuronale qui vont bien au-delà de la simple correction du déficit auditif. La stimulation permanente des voies auditives favorise un recalibrage des connexions synaptiques et contribue à une meilleure intégration des signaux sonores au sein du système cognitif. Les professionnels de santé que sont les audioprothésistes jouent un rôle important dans cette transformation en accompagnant leurs patients avec une approche pédagogique et personnalisée. En expliquant de façon simple les mécanismes de la plasticité et en intégrant des protocoles de rééducation adaptés, ils maximisent les bénéfices des aides auditives tant sur le plan auditif que cognitif.
Références
Kral, A. & Eggermont, J.J. (2007). Developmental plasticity of the auditory cortex. Trends in Neurosciences.
Sharma, A., Campbell, J., & Cardon, G. (2015). Plasticity and reorganization of the human central auditory system in children with hearing loss. Neural Plasticity.
Peelle, J.E. (2017). The neural consequences of hearing loss. Trends in Cognitive Sciences.
Lin, F.R., Yaffe, K., et al. (2013). Hearing loss and cognitive decline in older adults. JAMA Internal Medicine.
Rönnberg, J., Lunner, T., et al. (2016). The Ease of Language Understanding (ELU) model: Theoretical, empirical, and clinical advances. Frontiers in Systems Neuroscience.
Wong, P.C.M., Jin, J.X., et al. (2009). Aging and hearing loss: Impact on the central auditory system. Neuroscience & Biobehavioral Reviews.
Article rédigé par Benjamin Chaix.
Audioprothésiste D.E, Membre du Collège National d’Audioprothèse
Continuez la lecture
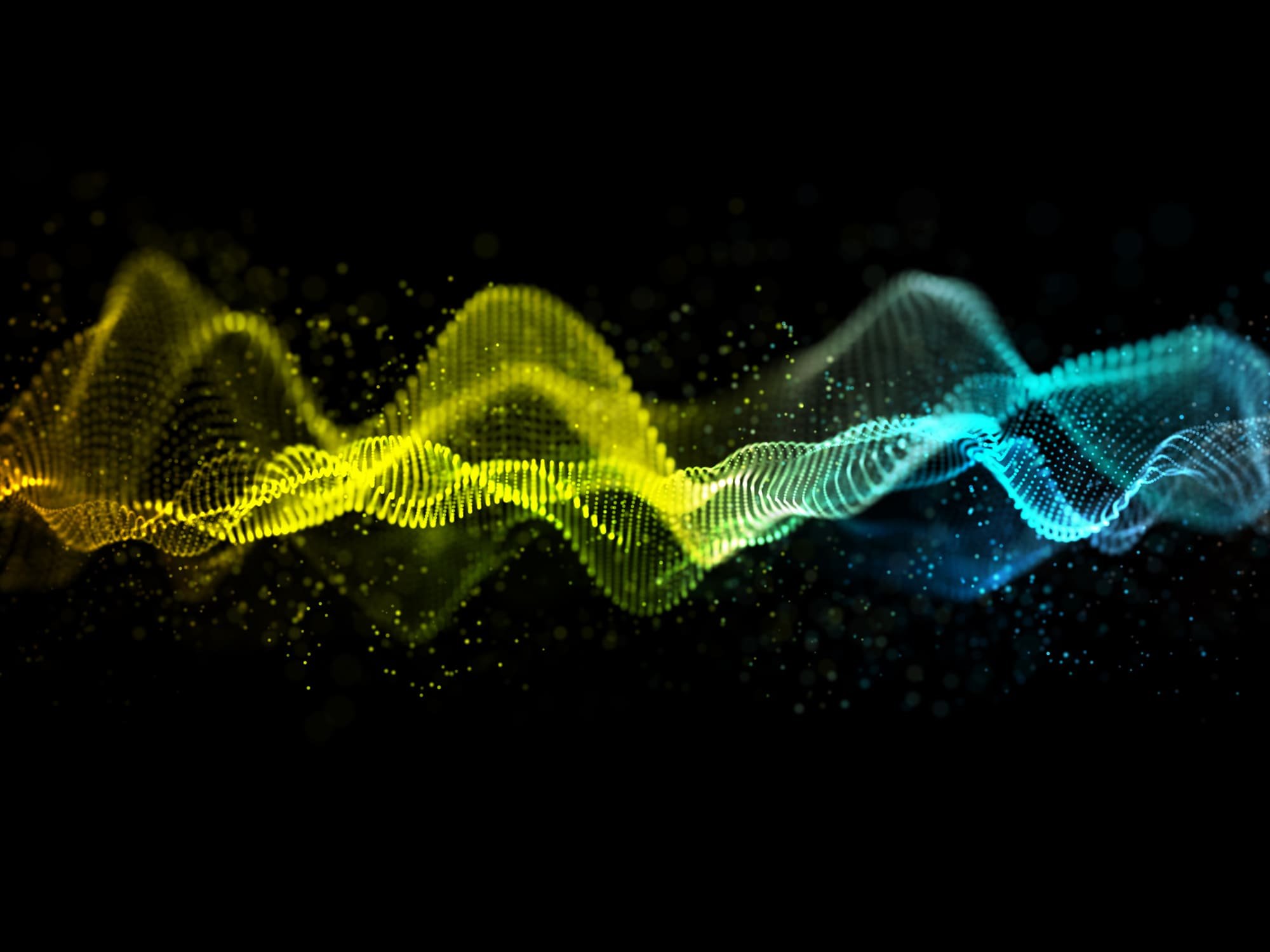
04 juin 2024
Démasquage binaural: la clé pour comprendre dans le bruitPar Antoine LORENZI, Métier
Lire l'article
12 mars 2024
Test auditif dans le bruit: utilité, application, précautionPar Antoine LORENZI, Métier
Lire l'article
